Un parricide en 1831 à Plonéis
- 13 août 2025
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 21 oct. 2025
Extrait de mon deuxième livre "La terre aux sabots".
2e prix d’histoire,
décerné par l’association des écrivains bretons en 2013.
Le samedi 26 novembre 1831, vers cinq heures du soir, Louis-Marie Thomas revient du marché de Quimper. Fatigué par le trajet, il hésite avant de franchir le seuil du cabaret de Jean Le Berre. Ce dernier étant occupé par son activité annexe de tisseur, sa femme Guillemette sert l’unique client, Louis Lagadec père, forgeron au village de Kervennou. Avec insistance, celui-ci invite l’adjoint au maire à boire un coup d’eau-de-vie.
Lagadec en est déjà à son troisième verre lorsqu’arrivent son fils Louis et Jérôme Le Floch. Les deux hommes marchent d’un pas mal assuré. Le père les invite à sa table et commande une bouteille de vin. Mais, bien vite, le ton monte et Lagadec père demande des comptes à son fils. Le matin, il lui a confié vingt-quatre francs pour acheter du fer à la foire de Quimper et pour prendre un pourpoint à sept francs, commandé chez un tailleur.
Le fils ne rapporte qu’une barre de fer, payée dix-sept francs. Le père réclame les sept francs manquants, traite son garçon de bordeller (débauché)[ et l’accuse d’avoir bu à ses dépens. Avant de quitter les lieux, Thomas tente de calmer le père Lagadec que l’aubergiste refuse de servir à nouveau. Prié de s’en aller, l’homme repart chez lui vers six heures et demie, « pas ivre, mais fortement pris de vin ». Quand Jeanne Nicolas, son épouse, le voit dans cet état, elle prend peur, car il a l’habitude de la maltraiter quand il a bu. Il la soufflète plusieurs fois, mais « un fagot s’étant rencontré entre ses jambes », il tombe et la malheureuse prend la fuite. Les vêtements déchirés, elle va se réfugier chez sa voisine qui ne s’inquiète pas outre mesure !
« Elle me dit que c’est son mari qui l’a mise dans cet état. Je lui allume du feu et je rentre dans mon lit ».
Éviter la dispute
Louis Lagadec fils ignore ce qui se passe à Kervennou lorsqu’il quitte l’auberge vers huit heures du soir. « Il a bu, mais il ne fléchissait pas ». Jérôme Le Floch lui propose de « coucher avec lui », et de ne pas retourner à Kervennou, son père étant indisposé contre lui. « Il ne fallait pas rentrer dans sa maison pour éviter la dispute ». Lagadec refuse, prétextant que son père ne le laissera pas tranquille tant qu’il n’aura pas été à Saint-Germain chercher un charbonnier pour carboniser du bois.
« Observant qu’il est difficile de voyager de nuit sans un bâton », il en emprunte un en néflier à Le Floch et se rend vers neuf heures du soir chez Vincent Le Cornec avec qui il doit faire la route le lendemain matin. Celui-ci est absent et Marie Tymen, sa femme, est au lit. Lagadec déclare qu’il va attendre le maître de maison et s’endort sur un escabeau. Trouvant inconvenant qu’il couche chez elle alors que son mari n’est pas là, « je dis à deux domestiques femelles que j’avais chez moi de ne pas se coucher avant d’avoir fait sortir Lagadec ». Chassé de la maison, il se résout à retourner chez son père.
Aussitôt arrivé, il se jette sur son lit, placé près de la porte d’entrée. La pièce est simplement éclairée par des branches d’ajonc qui brûlent dans le foyer. Le père est couché et boit un verre d’eau-de-vie que lui apporte Pierre-Guillaume, son jeune fils. Entre deux bouffées de pipe, il traite Louis de polisson et de vagabond. À ces mots, ce dernier sort de son lit, se met à jouer du bâton, frappant sur la table, sur l’escabeau et sur le lit du père. Celui-ci se lève et hurle que « puisqu’il l’a nourri, il saura bien se faire obéir de lui ». Alors que le vieux a un pied sur l’escabeau et l’autre sur le foyer, son fils lui assène un violent coup de bâton sur la tête.
Privé de tout sentiment
Le père a beau crier, supplier, « Pardon, mon fils, reste tranquille », les coups pleuvent sur le malheureux qui tombe à terre, « privé de tout sentiment ». Le jeune Pierre-Guillaume tente de calmer son frère et, avant d’être frappé à son tour, sort précipitamment et va appeler les voisins : « Venez donc vite, l’entendez-vous qui frappe sur mon père comme sur un morceau de bois ? Louis est à tuer mon père » ; puis il ajoute peu après : « Mon père n’existe plus ». La mère accourt et découvre le drame. Son mari est étendu sur « le sol imbibé de sang », les pieds tournés vers le foyer et la tête vers la porte.

Prévenus par Vincent Le Floch, Jean Sizorn, meunier, et Vincent Perchec, menuisier, trouvent le meurtrier au lit. « Le malheur est arrivé. Faites ce que vous voudrez de moi ». Alors que Le Floch s’apprête à aller prévenir le maire, Lagadec demande calmement qu’on lui rapporte une pipe du bourg, la sienne étant cassée. D’après un témoin, il passe la nuit à fumer sur le cadavre de son père, à boire et à manger à plusieurs reprises.
Dès le lendemain, le procureur du roi, et le juge d’instruction, se rendent à Kervennou, accompagnés d’un médecin, d’un interprète et du maire. Le meurtrier déclare que « le père était disposé à me frapper, et s’il était venu jusqu’à moi, il m’aurait arraché la vie ». Le corps est transporté sur la table près de la fenêtre, « mais le jour ne permettant pas de se livrer à l’autopsie cadavérique, nous avons prié le docteur Follet de faire l’autopsie le lendemain matin ». Louis Lagadec fils est conduit à la maison d’arrêt de Quimper.
Lors de son incarcération, le concierge inscrit sur le registre le signalement du meurtrier : un mètre et cinquante-huit centimètres, nez aquilin, cheveux et sourcils châtains, teint brun, yeux noir, portant une cicatrice au front. Lagadec porte une mauvaise chemise, une grande culotte en berlingue, un gilet et une veste en étoffe bleue, un chapeau feutre « le tout à la mode costume de la campagne ».
Le choc d’un objet contondant
Le lundi, les sieurs Gestin, Duc et Follet, médecins, dissèquent le cadavre de cinq pieds, cinq pouces. « La mort ne peut être attribuée qu’aux désordres cérébraux qui ont été le résultat du choc d’un objet contondant sur la tête ». Le rapport, joint au dossier d’instruction, est fort précis. On retiendra seulement que les médecins ont constaté « deux plaies très considérables, l’une à la partie gauche de la tête, l’autre à la partie occipitale ».
Ce qui est fait est fait
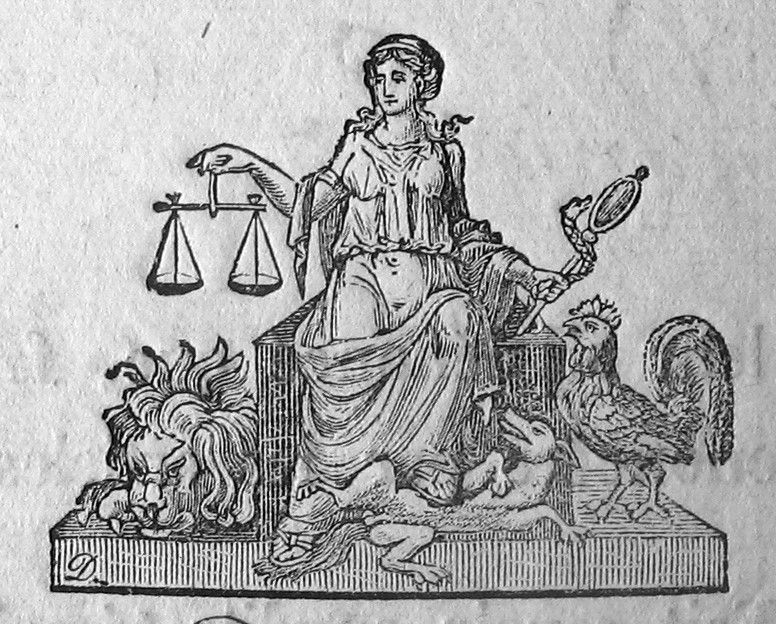
À l’audience du mercredi 4 avril, Louis-Marie Thomas est l’un des rares témoins à s’exprimer en français. Comme l’accusé, les autres parlent « l’idiome breton ». Louis Lagadec fils, célibataire, ne sait ni lire, ni écrire, et déclare qu’il est ouvrier-maréchal (ferrant).
Maître Le Guillou, avoué, conseil commis d’office, demande l’acquittement de son client, alors que le procureur royal, estime que la faute mérite une sanction infamante. Lagadec déclare qu’il n’a rien à rajouter. Pendant son séjour en prison, il n’a cessé de répéter : « Ce qui est fait est fait, si mon père est mort, il est mort ».
À la question : « Louis Lagadec est-il coupable d’avoir, le 26 novembre 1831, commis volontairement un homicide sur la personne de Louis Lagadec, son père ? », la réponse donnée par le chef du jury, après huit minutes de délibération, est non. Un grand murmure s’échappe de l’assistance et le président Hyppolite-Sulpice de Beschu de Champsavin, outré par ce scandale judiciaire, frappe l’accusé d’anathème.
En sortant de la salle de délibérés, un juré dit à un gendarme : « Courez et allez consoler ce malheureux, dites-lui qu’il est acquitté». Lagadec va fêter son acquittement dans un cabaret avec quelques témoins. D’après le président, « la décision du jury a provoqué l’indignation la plus vive sur la classe éclairée et a jeté l’effroi dans les campagnes voisines ».
Le 15 avril 1832, le verdict est largement commenté lors de la réunion du conseil municipal de Plonéis. On raconte que l’acquitté, croisant le président le lendemain près de la prison, l’aurait salué en riant. Les avis des conseillers sont partagés sur la décision du jury, car le père Lagadec était craint par beaucoup. Certains estiment que l’acquittement a été motivé par la philanthropie, d’autres pensent que c’est de la mollesse.
Peu après, René Le Pensec, un journalier, est condamné à un an et un jour d'emprisonnement pour avoir volé un écheveau de fil qui séchait dans le jardin du notaire de Landudec.
Selon que serez puissant ou misérable...








L'ensemble du livre est très documenté grâce aux recherches très poussées de l'auteur. Passionnant pour mieux connaitre ce secteur de Basse Bretagne.
Les verdicts surprenants ne datent pas d'aujourd'hui...
Cette histoire très réaliste, et fort bien écrite, évoque les conséquences et les ravages de l'alcoolisme endémique qui sévissait à cette époque.
C'est ce constat qui avait conduit le pasteur gallois évangéliste William Jenkyn Jones (1852-1925) à œuvrer dans le Finistère lors de la seconde partie du XIXe siècle pour combattre cette situation.
Par ailleurs, la description du détenu par le concierge, lors de l'incarcération du premier, est très précise. Elle est pour moi l'occasion de redécouvrir la "berlingue", ce tissu composé d'un mélange de laine et de lin dont était constituée la "grande culotte" du meurtrier.
Les faits divers d'autrefois ne sont pas moins horribles que ceux d'aujourd'hui !